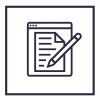Cet article a été publié en 2010 dans le cadre du numéro 28 des cahiers de Global Chance en collaboration avec Politis : Science, pouvoir et démocratie. faisant acte du colloque « Science et démocratie » organisé le 20 novembre 2010 par l’AITEC, la Fondation Sciences citoyennes, Global Chance et Politis. Cette intervention fut suivie d’un débat reproduit dans ce numéro.
La médiatisation scientifique : vulgarisation ou culture ?
Il a fallu à mes amis beaucoup d’insistance pour me convaincre de participer à cette riche journée. Je ne suis pas une spécialiste des médias, et je ne suis pas une scientifique. Tout ce que je peux proposer, c’est de témoigner : depuis dix ans, je suis productrice sur France Culture d’une émission de radio consacrée à l’environnement, donc amenée à parler de sciences sur un média.
J’ai commencé par cet aveu, je ne suis pas une scientifique. C’est pourquoi pendant longtemps, je me suis auto-disqualifiée pour tout ce qui concernait les sciences. Ce n’était pas faute d’intérêt, j’avais souvent envie d’en savoir plus sur les trous noirs, le nucléaire, le climat... A chacune de mes tentatives pour lire un article dans une revue spécialisée, je renonçais au bout de quelques paragraphes. Trop obscur, trop compliqué, hors de ma portée... Je n’étais pas à la hauteur.
Lorsqu’on m’a confié la charge d’une émission sur l’environnement, j’ai attribué ça à une erreur de casting. Ceci dit, je n’étais pas un cas isolé. Nombre de mes confrères et consœurs, littéraires eux aussi, se retrouvaient chargés des questions scientifiques dans différents médias, presse écrite ou audiovisuel. A noter d’ailleurs qu’on les trouvait également dans les rubriques économiques. Certains d’entre eux étaient « appareillés » : on les entourait de sommités de l’Académie des Sciences ou de la Médecine qui choisissaient avec eux les thèmes à traiter et leur indiquaient les bons experts à interroger. Ils n’étaient pas les mieux lotis.
Finalement, mon approche des sciences a été autre, déterminée par ce que je savais faire. En fait, je suis douée pour les langues, c’est un don familial, j’apprends aisément les langues étrangères, quelques mots me suffisent pour comprendre un sens général, retrouver un contexte et même saisir des nuances. Lorsque je me suis plongée dans ces domaines si intimidants, la physique, la chimie, les statistiques, la génétique, la botanique, il m’est vite apparu que les questions de langue étaient primordiales. Comme partout ailleurs, la langue servait à dévoiler, à dissimuler, à suggérer, à égarer ou à attirer. Elle était écran ou ouverture, accueillante ou repoussante.
C’est vrai, dans les textes scientifiques que j’ai été amenée à lire pour préparer mes émissions, il y a des formules, des vocables, des descriptions que j’ai du mal à retenir ou même à comprendre. Mais si j’évoque un cross-fed, un shunt ou un effet de gauche-droite, rares sont ceux qui sauront de quoi il est question. Ce qui n’empêchera personne de comprendre l’émission de radio qui a été mixée en studio avec des collègues dont je partage la langue.
Ce qui est intéressant pour les citoyens que nous sommes, dans les sciences, ce n’est pas la cuisine interne, la langue du métier, ni même les arguties sur tel ou tel point qui fait débat entre virtuoses. Ce que nous voulons connaître, c’est tout ce qu’il y a autour : qui a décidé de lancer telle recherche et dans quel but ? Quelles sont les conséquences de telle manipulation et pour qui ? Qu’est-ce qui est nécessaire, désirable, utile, voulu ?
Question de langue, disais-je. Le mot couramment employé pour désigner le fait de rendre accessibles des connaissances scientifiques, c’est « vulgarisation ». Comme dans « vulgaire ». Je préfère penser qu’il s’agit de construire une culture commune, une culture qui aujourd’hui fait encore trop souvent défaut. Les médias ont leur part de responsabilité dans cet état de fait : ils répugnent à déplaire. Or, la complexité est réputée rebutante ; mieux vaut donc ne pas en parler, ou édulcorer. Mais le monde scientifique aussi est directement actif dans cette mise à l’écart des citoyens. Quelques anecdotes illustreront ces deux affirmations.
En 2006 s’est tenu à Rouen le premier congrès sur les pathologies environnementales, à l’initiative d’un groupe de médecins et à destination d’un public de médecins. Un professeur, enseignant en CHU et spécialiste des allergies respiratoires fait une communica
tion dans laquelle il établit clairement un lien entre la circulation automobile et les problèmes respiratoires. J’étais la seule journaliste dans la salle. Après la matinée, je me rends à la conférence de presse à laquelle ce professeur participait, pour l’interviewer. Et là, je l’entends expliquer avec un fin sourire qu’il y a peut-être une vague relation entre circulation et problèmes respiratoires, mais voilà, c’est le signe que l’être humain ne s’est pas encore pleinement adapté à la voiture... Ce qu’on pouvait se dire entre soi n’était pas bon pour des oreilles de journalistes. Ils sont toujours si prêts à dramatiser, n’est-ce pas ?
Au cours d’une émission, j’ai invité deux scientifiques qui avaient manifestement une connaissance extrêmement précise des questions nucléaires, Benjamin Dessus et Bernard Laponche, en face de la ministre de l’industrie de l’époque et du responsable de communication d’Areva. Aux deux premiers qui faisaient état d’erreurs grossières dans un rapport, erreurs qui avaient échappé aux autorités, et demandaient donc un débat contradictoire sur ces questions importantes, l’envoyé d’Areva répondait par des arguments tels que : « les déchets du nucléaire, c’est l’équivalent d’un camion de pompiers ». D’un côté la demande d’un échange ouvert, collectif, afin de prendre des décisions qui nous concernent tous ; de l’autre un discours de « communiquant », un beau camion rouge tout rutilant, toutes sirènes dehors, de quoi nous sauver d’un débat peut-être difficile.
Ce décalage entre les « niveaux de langue », je l’ai éprouvé à de nombreuses reprises. Chaque fois, en fait, que j’ai tenté d’organiser cet exercice qui est considéré comme le nec plus ultra de la médiatisation audiovisuelle : le débat contradictoire, justement.
La controverse est une bonne chose. Elle est nécessaire dans les milieux concernés et permet certainement d’avancer sur des points de doute, voire de litige. En revanche, sa version médiatique est tout autre. Elle tourne régulièrement à la mise en scène d’un pugilat version Guignol contre Gnafron, le plus éloquent, le plus drôle ou le plus rentre-dedans ayant systématiquement le dessus, sans que les arguments avancés entrent jamais en ligne de compte. Il ne s’agit plus là de controverse, mais de polémique. Contrairement aux jeux du stade barbares où il fallait voir couler le sang, notre époque apprécie le match nul et je me souviens d’une collègue soupirant d’aise : « Moi, ce que j’aime, c’est quand les auditeurs ne savent plus quoi penser à la fin d’un débat ».
Pas moi. J’ai vite compris que les questions que j’étais amenée à traiter étaient trop graves pour les cantonner à la seule polémique. Le changement climatique, la déplétion pétrolière, l’accumulation de substances chimiques toxiques dans les sols, les eaux, l’air, l’effondrement de la biodiversité... En dix ans, j’ai vu qu’on les niait, puis on les a minimisées et aujourd’hui on prétend les résoudre par la magie, fermez les yeux, tout va rentrer dans l’ordre sans qu’on change rien.
Nous devons aujourd’hui acquérir une nouvelle culture. Les sujets d’environnement sont d’ordre scientifique, et nous avons besoin qu’un certain nombre de connaissances soient mises à la portée du plus grand nombre. Mais au-delà, ce sont des questions sociales, économiques, avant tout politiques. Les difficultés sont nombreuses, je les éprouve dans l’exercice de mon métier et elles sont, me semble-t-il, largement partagées. Il y a le manque de temps. Pour faire une heure d’émission par semaine sur tous les thèmes que j’ai évoqués et bien d’autres, l’agriculture, la botanique, l’énergie, l’économie, qui tous concernent l’environnement, je n’ai jamais obtenu qu’on m’accorde un poste, voire un demi-poste de documentaliste. Je travaille seule, je fis, j’assiste aux conférences et colloques sans aucune aide. Manque de temps, qui conduit à un isolement. J’ai longtemps été la seule à traiter ces sujets sur France Culture et je ne vois pas quand je pourrais aller discuter ou échanger avec mes collègues d’autres médias. D’ailleurs, eux aussi sont débordés et, comment dire... « empêchés » de faire le travail de fond que tous estiment nécessaire aujourd’hui. Autre difficulté : l’extrême complexité des sujets scientifiques et environnementaux. J’ai de la chance : une heure, cela permet de développer un certain nombre d’idées. A condition de résister aux courants de mode qui voudraient qu’on saucissonne le temps, en multipliant les rubriques, les chroniques, les musiques. Ailleurs, dans la presse écrite par exemple, l’espace est aussi rare que le temps. A cela s’ajoute une sorte de léthargie collective qui rend de plus en plus inhabituel de se concentrer sur un sujet. On s’habitue facilement à faire vite, à passer d’une chose à l’autre, à trancher. Les messages dont nous sommes abreuvés, les images, les slogans, les clips et les pancartes sont tous brefs, concis, univoques... et encombrants. La pensée doit se frayer un chemin dans cet amoncellement d’obstacles qui la divertissent sans la nourrir. Cela demande certainement davantage de volonté aujourd’hui.
Encore une anecdote. Au début de ce siècle, je me suis intéressée simultanément à deux affaires : la vache folle et l’huile frelatée en Espagne. Un agriculteur anglais avait une hypothèse. Il faisait un lien entre l’encéphalopathie spongiforme et un traitement qu’on avait imposé à l’ensemble du cheptel bovin en Europe, pour éviter qu’un moucheron ne troue leur peau et n’entrave ainsi l’industrie du cuir. Par ailleurs, un Français avait publié un livre, résultat d’une longue enquête qui mettait en cause l’épandage de pesticides non autorisés sur les champs de tomates en Espagne, lequel pourrait être responsable de la mort de nombreuses personnes, qu’on avait imputée à un lot d’huiles frelatées. J’étais bien en peine de me faire une opinion sur ces deux hypothèses, même s’il me semblait que la seconde était plus vraisemblable que la première. J’ai pris conseil auprès d’un des (trop rares) écotoxicologues que nous avions encore en France à l’époque. Et lui a jugé l’histoire du moucheron bien plus vraisemblable que celle des tomates. Finalement, on n’a jamais eu le fin mot ni de l’une, ni de l’autre. C’est regrettable, bien sûr, d’autant que je n’ai jamais réussi à me faire une « opinion ». Mais au passage, j’avais appris qu’en Europe, on obligeait les agriculteurs à badigeonner la colonne vertébrale de leurs vaches avec un produit chimique ultra-toxique pour éradiquer un moucheron dont le seul tort était de percer des trous minuscules nuisibles à l’industrie du gant et non à la santé bovine. Et qu’en Espagne, on se livrait à des expériences clandestines en déversant du haut d’un avion des tonnes d’un autre produit chimique non autorisé.
Et là ce sont des faits, non des opinions.
 Global Chance
Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992
Global Chance
Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992