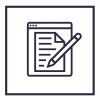Cet article a été publié en 2010 dans le cadre du numéro 28 des cahiers de Global Chance en collaboration avec Politis : Science, pouvoir et démocratie. faisant acte du colloque « Science et démocratie » organisé le 20 novembre 2010 par l’AITEC, la Fondation Sciences citoyennes, Global Chance et Politis. Cette intervention fut suivie d’un débat reproduit dans ce numéro.
Comment savoir la vérité ? Comment choisir les innovations ?
On peut considérer deux formes d’expertises : celle qui prétend dire la vérité des faits et celle qui formule des recommandations pour les conduites humaines. On accorde la première exclusivement aux scientifiques tandis que la seconde est normalement partagée par d’autres savoirs que les sciences « dures » et doit conduire à des choix politiques. Pourtant la vérité scientifique peut influencer les choix politiques si bien qu’on peut parfois suspecter que la nature de ces choix modifierait la vérité elle-même...
Quand les Grecs affirment que la Terre est ronde, cinq siècles avant JC, cette hypothèse est discutée paisiblement, comme n’importe quelle idée nouvelle, avant de s’imposer à tous avec la science moderne. Mais quand deux siècles plus tard apparaît la thèse héliocentrique (le soleil, et non la terre, est au centre de l’univers), l’idée est rejetée violemment et sa réaffirmation par Copernic au 16° siècle vaudra bien des ennuis à Galilée. Quelle différence entre ces deux productions de la science ? Il était indifférent pour toute idéologie que la Terre soit plate ou ronde alors que sa position excentrée dans l’univers menaçait des choix métaphysiques : elle fut qualifiée d’hérétique et combattue comme telle. Depuis que la science s’est émancipée de la religion, on imagine que ces vieilles histoires sont dépassées et que la vérité affirmée aujourd’hui par les scientifiques est indiscutable. C’est sans compter avec la substitution des religions par l’idéologie néolibérale à prétention scientifique et les préceptes qui en découlent (concurrence,marchés, croissance...). Prenons l’exemple des changements climatiques. Que le climat se modifie rapidement est une vérité aussi neutre idéologiquement que la sphéricité de la Terre. Elle est donc acceptée par tous (ou presque) comme un fait indiscutable dont T origine est à analyser. En revanche, si on affirme que ce constat a une origine anthropique on met les pieds dans le plat de l’idéologie comme avaient fait ceux qui défendaient l’héliocentrisme ! Et la guerre pour la « vérité scientifique » mobilise alors ceux qui ont intérêt à une autre « vérité », et ceux qui les servent. Car on comprend bien que si les activités humaines s’avèrent être à l’origine de risques vitaux il devient urgent de vivre autrement et ainsi de renier tout ce qui fait fortune aujourd’hui. Dans ces conditions, le citoyen peut-il savoir où est la vérité ? Dans notre exemple c’est assez simple : de même que la Terre est ronde et tourne autour du soleil, les climats changent très vite et c’est à cause des activités humaines. Que cette dernière vérité, la seule controversée, soit portée par une armée de scientifiques (GIEC) est un argument de poids mais il ne devient décisif que parce qu’il contredit les intérêts de la machine qui nous dirige. Ainsi les citoyens peuvent-ils croire les scientifiques quand la vérité qu’ils annoncent est défavorable à ceux qui nous dirigent (ce qui montre que les écolos ne sont pas systématiquement anti-science...) mais qu’en est-il quand la vérité conforte le système politico-économique ? Cette situation arrive fréquemment quand les commissions d’expertise rassurent là où on a des raisons de s’inquiéter comme sur l’innocuité des plantes transgéniques, des perturbateurs endocriniens, ondes électromagnétiques et autres nanotechnologies... On ne peut pas, bien sûr, en déduire automatiquement que ces vérités-là seraient fausses, mais on est en droit de les trouver suspectes, et il faudrait alors disposer d’une instance neutre et d’objectivité optimale pour en juger.
Dans ce domaine de l’expertise technique et scientifique au service de la décision publique, la compétence est souvent hybridée avec des intérêts particuliers. Car l’expert, même universitaire, se trouve presque toujours en conflit d’intérêts puisque sa compétence, ou sa notoriété, n’aurait pu être acquise sans les soutiens apportés par l’industrie à son laboratoire de recherche. Au cours des dernières années, de nombreuses expertises officielles ont été remises en cause, surtout dans les domaines de la santé et de l’environnement. La caution quasi systématique donnée aux innovations est bien sûr partagée par les instances européennes : on peut se demander à quoi sert de demander encore l’expertise de l’Agence européenne de sécurité des aliments (AESA) sur l’innocuité de telle plante transgénique quand les nombreux avis rendus par cette agence ont tous été positifs... La pression des lobbies industriels sur les instances d’expertise est évidente et parfois démontrée comme, au niveau international, par la collusion des experts de l’OMS avec les producteurs de vaccins afin de dramatiser la gravité du virus de la grippe A H1N11. En revanche, il est rare que la malhonnêteté d’un expert soit démontrée et ce n’est que de façon différée . Pourtant, la défense obstinée de l’expertise officielle ne veut pas tenir compte de ces faits. Ainsi une journaliste écrit en défense des Académies : « remettre en cause systématiquement des institutions honorables, c’est prendre le risque de museler les authentiques experts et de laisser le champ libre aux seuls militants, n’ayant pas forcément les compétences techniques et qui, eux aussi, peuvent être pris dans des conflits d’intérêts cachés... » Cet argumentaire oppose le militant à l’expert quant à leurs compétences respectives, mais c’est en omettant que la société civile s’est donné dans de nombreux domaines des moyens d’expertise de qualité , et aussi qu’il ne suffit pas d’être académicien pour devenir expert universel : en quoi le chimiste Jean- Marie Lehn, le cancérologue Maurice Tubiana ou le géologue Claude Allègre ont-ils compétence pour affirmer qu’on doit accepter l’ensemble du paquet technologique contemporain : plantes transgéniques, centrales nucléaires, ondes électromagnétiques et nanoproduits ? Pourquoi des journalistes cèdent-ils à cet effet d’autorité institutionnelle en sollicitant ces scientifiques hors de leurs spécialités ?
Pour Marcel Gauchet, la période actuelle évoque un retour des anciens régimes marqués par une forte hiérarchie sociale. Le « non instruit » est ainsi considéré comme un archaïque auquel on oppose : « vous ne savez rien, laissez nous faire ». Ce qui permet à l’élite d’œuvrer ensuite dans ses propres intérêts. « On passe donc d’une élite à une oligarchie » conclut-il . Dans une tribune de 2005, Hervé Kempf remarque que « les parlementaires acceptent souvent mal ce qu’ils ressentent comme une diminution de leur rôle : ainsi, par exemple, Patrick Ollier, député (UMP) des Hauts- de-Seine, conteste-t-il à la Commission nationale du débat public (CNDP) le droit de dire que le débat a vocation à permettre aux Français de s’exprimer sur le principe du réacteur EPR. Ce « débat démocratique a déjà permis aux Français de s’exprimer, par la voie de leurs représentants légitimes », écrit-il au président de la commission en septembre » . Où il se confirme que le mépris de l’avis des citoyens, constaté pour les choix politiques (referendum sur la Constitution européenne, loi sur les retraites, etc...) n’épargne pas les choix technologiques, et donc qu’il s’agit bien de définir et d’exiger d’autres rapports entre la société civile et ceux qu’elle a élus.
Il est urgent de définir des règles, de nature éthique, pour tendre vers des procédures plus objectives et mieux conformes aux intérêts des populations. Car une innovation contraire à l’intérêt général est aussi le contraire d’un « progrès », c’est donc un devoir démocratique de démasquer les expertises complices de certains projets. Or, on ne peut plus croire que les innovations soient toujours bénéfiques pour les populations, ni que tous les artifices soient longtemps supportables par la planète, ce qui implique que les avis sur l’opportunité des « progrès » ne peuvent provenir que du dehors de la sphère des producteurs de ces progrès. C’est pourquoi une expertise conséquente doit utiliser le rapport des experts scientifiques et non être constituée par ce rapport. La création d’une Haute Autorité de l’expertise permettrait de combler le vide scientifique et civique entre la parole des experts interrogés et la décision du législateur. Une telle structure avait été proposée par la Fondation Sciences Citoyennes lors du Grenelle de l’environnement et développée par Corinne Lepage dans un rapport officiel, lequel fut vite remisé par le gouvernement qui l’avait commandité . La Fondation sciences citoyennes vient de proposer une loi pour créer cette Haute Autorité. [1]
Il ne s’agirait pas d’une énième assemblée d’experts mais d’un comité déontologique chargé de définir et vérifier les conditions d’exercice de cette activité indispensable qu’est l’expertise.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la bonne pratique éthique, scientifique et démocratique de l’expertise. D’abord elle doit être contradictoire parce qu’il n’est pas de vérité scientifique issue d’un seul point de vue, et que la technoscience n’est pas une activité neutre . L’incertitude, déjà fréquente dans l’expression des faits comme on l’a évoqué plus haut, augmente quand il s’agit de prévoir les avantages et les nuisances d’une technologie. Aussi, à chaque fois qu’il existe différentes positions scientifiques à propos d’une innovation (c’est-à-dire quasiment toujours), l’expertise ne devrait pas valoriser la plus « optimiste » (ou permissive) mais ouvrir un débat entre « sachants » devant une commission pluraliste composée de scientifiques variés mais aussi de représentants des associations concernées. Les termes « sachants » et « scientifiques » ne sont pas l’apanage des sciences dures, mais s’appliquent ici à toutes les disciplines du savoir dans une démarche résolument multidisciplinaire. Il faut prévoir que le jugement d’une telle commission nécessiterait à chaque fois une formation préalable ad hoc. De plus, l’ensemble de ces procédures doit être transparent, ouvert au public et aux médias aux fins d’information de la société mais aussi pour en conforter l’indépendance. Quant aux données résultant d’essais déjà réalisés, qui sont nécessaires pour construire l’avis, elles ne doivent pas être dissimulées sous couvert de « secret industriel » comme c’est la règle aujourd’hui.
C’est la Haute Autorité de l’expertise et de l’alerte (HAEA) qui aurait aussi en charge le suivi des alertes, en particulier dans les domaines de la santé et de l’environnement. Les lanceurs d’alerte deviendraient enfin protégés par une loi comme c’est déjà le cas dans de nombreux pays, tandis que leurs arguments et informations seraient soumis à l’analyse critique. L’examen systématique des alertes, conforme à la précaution, irait aussi dans le sens du bien commun, même si seulement une alerte sur dix devait s’avérer pertinente.
On en vient à la grave question de la décision politique. La participation est dans l’air du temps et le champ qu’elle couvre s’est largement étendu depuis De Gaulle, depuis le partage économique jusqu’ à l’intelligence sociétale, en même temps que son contenu démocratique se diluait dans le verbiage et l’aliénation. Est-ce vraiment participer que donner son avis quand personne n’en tiendra compte ? Quand les décisions politiques ont déjà été prises en amont ? A ce jeu, les ruses des lobbies sont infiniment plus efficaces que la bonne volonté des citoyens ! Pourtant, dès que les incertitudes sur l’intérêt et les conséquences des technologies sont importantes, ce qui est de plus en plus fréquent, les autorités devraient collecter et discuter les points de vue des simples citoyens, au- delà du cercle des experts statutaires ou des associations spécialisées. Bien sûr, pour qu’il soit argumenté, l’avis des citoyens doit se nourrir des informations les plus complètes possibles. C’est pourquoi il faut définir une méthodologie permettant de recueillir les avis de citoyens « naïfs » (non spécifiquement impliqués dans la controverse) mais bien éclairés grâce à des informations complètes et contradictoires. Les bases pour une telle procédure ont été proposées il y a 20 ans par le Danemark sous l’appellation « conférence de citoyens » (CdC) mais, malgré plusieurs dizaines de CdC recensées dans de nombreux pays, la méthodologie reste empirique et sujette à de larges variations. Or, la crédibilité des CdC exige que des règles claires en garantissent l’objectivité et la pertinence. C’est seulement à ce prix qu’on pourrait obtenir des parlementaires qu’ils prennent en compte les résultats des CdC au moment de faire les lois et règlements. C’est pour rompre avec l’ambiguïté de procédures variées s’autoproclamant « conférence de citoyens » que nous avons adopté la dénomination « convention de citoyens », pour un projet législatif. [2] Selon ce projet de loi la sélection d’une quinzaine de citoyens, profanes par rapport au sujet en délibération et dénués de conflit d’intérêts, est effectuée au hasard mais en assurant une grande diversité (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région d’origine, sensibilité politique...). L’objectivité de la procédure est recherchée à la fois par cet échantillonnage, par une formation assurée hors de toute influence (anonymat des citoyens) et par le consensus obtenu sur le programme de formation, lequel est pourtant établi au sein d’un comité de pilotage riche d’opinions diverses.
Afin de sortir des leurres démocratiques et pour aller vers une véritable participation, les recommandations de la CdC doivent faire l’objet d’un débat parlementaire où toute divergence des élus avec les recommandations des citoyens devra être motivée. Car la démocratie participative ne peut devenir crédible aux yeux des citoyens que si les élus prennent en compte les avis émis. Ainsi pourrait-on mieux faire fonctionner les institutions, et fournir aux élus un outil pour apprécier toutes les facettes d’une innovation avant d’en promouvoir l’usage. Pourtant, la procédure CdC est largement galvaudée9 et quelques règles claires doivent être rappelées (voir annexe).
Deux extensions de ce modèle seraient ultérieurement possibles. On pourrait tenir simultanément plusieurs conventions de citoyens sur le même thème (par exemple avec un comité de pilotage dans chaque pays participant) et vérifier ainsi la convergence des souhaits des citoyens du monde, convergence qu’on peut supposer supérieure à celle de leurs responsables politiques respectifs... L’autre extension serait thématique en élargissant le recours à ces procédures hors des controverses technologiques vers des thèmes éthiques ou même politiques. C’est une véritable révolution des pratiques qui est en jeu avec cette formule pour forger les décisions des élus les mieux conformes à l’intérêt commun.
Mais l’actualité est de passer le premier cap de cette utopie en faisant inscrire les CdC dans la Constitution, condition pour garantir leur prise en compte... Et donc de convaincre les parlementaires que face à la complexité croissante des évaluations ils ne peuvent se suffire d’expertises incomplètes, souvent tendancieuses et peu conformes à l’intérêt des populations.
 Global Chance
Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992
Global Chance
Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992