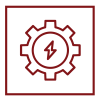Cet article a été publié en 2010 dans le cadre du numéro 28 des cahiers de Global Chance en collaboration avec Politis : Science, pouvoir et démocratie. faisant acte du colloque « Science et démocratie » organisé le 20 novembre 2010 par l’AITEC, la Fondation Sciences citoyennes, Global Chance et Politis. Cette intervention clôture le colloque.
Bien entendu, je ne vais pas conclure ce débat passionnant, mais au contraire essayer d’ouvrir vers d’autres initiatives.
Je voudrais tout d’abord rebondir sur une hypothèse qu’a proposée Benjamin Dessus en disant que la prégnance de la pensée économique dominante pourrait être un élément d’explication du relativisme qu’il dénonçait. Je suis fondamentalement d’accord avec cette hypothèse. Mais, il y a un autre point dans ce domaine qui me paraît important et qui est constitutif de la science économique dominante, c’est la confusion entre la valeur et le prix. Comme les prix fluctuent en fonction de la rareté, en fonction de l’utilité, en fonction de toute une série d’éléments subjectifs, les valeurs elles-mêmes perdent tout fondement stable. On arrive ainsi très vite à la confusion totale entre ce qui est de l’ordre du fait et ce qui est de l’ordre de l’opinion. Comme l’économie imprègne tout l’imaginaire et toute notre conception de la société, et qu’elle se revendique comme purement positive et non pas comme normative, alors qu’elle l’est fondamentalement, on aboutit à une confusion entre le positif et le normatif. Cette prégnance de l’économisme me paraît par conséquent un facteur explicatif important de la confusion qui s’établit aujourd’hui entre les faits et les opinions.
Je voudrais enfin revenir au changement climatique. Je pense en effet que les scientifiques du GIEC, malgré les imperfections et les limites que l’on peut légitimement formuler, nous donnent suffisamment d’éléments pour que nous puissions fonder rationnellement l’idée que l’activité humaine a une responsabilité dans le réchauffement climatique observé. Ce qui est intéressant, c’est de voir que malgré cela, les climatosceptiques rencontrent un certain écho. Je pense que leur réaction provient d’une forme de peur qu’ils partagent avec une partie des citoyens que nous sommes.
Que signifie en effet le fait d’assumer que le changement climatique est de nature anthropique ? C’est un événement parce que jusqu’ici il était possible de penser l’histoire naturelle, l’histoire de la planète, comme une histoire au très long cours, une histoire parallèle, mais indépendante de l’histoire humaine et sociale. Cette dernière apparaissait comme intemporelle et indépendante des grands cycles climatiques de la planète. Et puis, aujourd’hui, nous découvrons que non seulement nous subissons le changement climatique mais que nous « faisons » le climat. Événement qui nous oblige à repenser, comme le disait Gustave Massiah tout à l’heure, notre rapport au monde et à la nature. La temporalité humaine n’est plus insignifiante au regard de l’immensité des temps géologiques. Les sciences du climat nous montrent que l’être humain n’est plus seulement un agent biologique, il devient un agent géologique. L’anthropocène, qui a débuté avec la révolution industrielle succède à l’holocène, cette période de 10 à 12000 ans pendant laquelle nous avons bénéficié d’un climat tempéré qui a permis le développement de l’agriculture. Cela ne nous permet plus de penser, comme l’avait fait l’humanisme, en séparant les sciences sociales et les
sciences de la nature. Cela heurte des habitudes de pensée bien ancrées, celles d’une séparation stricte entre les sciences humaines et les sciences de la nature, jointe à une conception très particulière de la nature : une nature faite de concurrence, d’inégalités une nature inhospitalière. Il nous faut donc revoir le dialogue entre les sciences sociales et les sciences de la nature. Un autre élément de bouleversement tient au fait que le changement climatique, comme la perte de biodiversité, sont des conséquences non voulues de l’action humaine. Nous devons admettre que nous avons perdu la maîtrise sur ce que nous avons fabriqué. Et cela heurte de front une pensée qui a besoin de se rassurer en maintenant fermement cet artifice de séparation des domaines de la science et de la société.
Pour conclure, je souhaiterais revenir sur un propos de Jacques Testait sur la sagesse populaire et me référer à André Gorz, qui face à la crise écologique et sociale, redoutait l’émergence d’une expertocratie qui nous indiquerait les seuils à ne pas dépasser, qui déciderait des seuils de consommation et des besoins, au nom des lois des sciences de la nature, à la place des sociétés, qui déciderait finalement de ce qui est bon pour elles. Face à ce risque d’expertocratie, il préconise la reconquête du monde commun et du monde vécu. Cela me paraît important car cela rejoint l’idée de sagesse populaire (avec les limites qu’il faut donner à ce terme) : si le changement climatique reste largement aujourd’hui une construction abstraite, pour beaucoup de peuples ce n’est plus du tout une abstraction, parce que leurs lieux de vie sont modifiés, voire détruits par le changement climatique. Je pense donc que l’articulation entre un processus démocratique et toutes les connaissances dont nous avons absolument besoin est une nécessité, et que, dans ces connaissances, l’expérience vécue par les peuples constitue une richesse irremplaçable, assez systématiquement ignorée par la science occidentale de ces deux derniers siècles.
J’appelle donc tous les partenaires ici présents à continuer à se mobiliser autour de ces questions et à prolonger ce débat qui m’a semblé profondément enrichissant pour nous tous.
 Global Chance
Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992
Global Chance
Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992