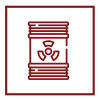Le modèle nucléaire français est à bout de souffle : sans un changement de cap rapide, nous serons confrontés dans une dizaine d’années à un choix impossible, entre fermer les réacteurs sans avoir mis en place les solutions alternatives, ou les prolonger dans des conditions de sûreté extrêmement dégradées. Mais l’indispensable transition énergétique se heurte à l’archaïsme d’EDF, qui se comporte de plus en plus comme un acteur privé jouissant d’un quasi-monopole et fait passer ses intérêts propres à court et moyen terme avant l’intérêt général à long terme, tout en se parant des vertus historiques du service public... Interview d’Yves Marignac, publié par le site d’information en ligne Médiapart le lundi 6 février 2012.
Sans doute peu connu, Yves Marignac est l’un des experts sur l’énergie les plus actifs aujourd’hui en France. Consultant à but non lucratif sur les risques nucléaires et les politiques énergétiques, il rédige notes et études pour des acteurs institutionnels et associatifs. Il dirige Wise-Paris. Cette association a été fondée en 1983 pour mettre à disposition du public des informations sur l’énergie et faciliter ainsi le jeu démocratique. Il vient de contribuer au Manifeste Négawatt, livre tout juste publié par le réseau d’experts éponyme sur la manière de réussir la transition énergétique.
C’est le cinquième volet de nos entretiens en vue de la présidentielle de 2012, où nous demandons à des chercheurs et intellectuels de livrer leurs analyses.
Propos recueillis par Jade Lindgaard.
Notre dépendance au nucléaire crée-t-elle un handicap pour le développement des énergies renouvelables, et plus largement, pour la transition vers un modèle plus économe et plus durable ?
Yves Marignac : J’en suis convaincu. L’énergie dans un pays fait système. Il y a une imbrication très étroite entre l’organisation d’une société et son système énergétique. Le nucléaire, s’il ne représente qu’environ 17 % de l’énergie que nous consommons en France, est totalement structurant. Par exemple, la question des transports est éclipsée de presque tous les débats énergétiques, alors que la consommation d’énergie dans les transports n’a cessé de croître, et que notre gestion de l’espace s’est complètement organisée autour du tout-voiture.
Plus généralement, les grands acteurs du système ne savent pas appréhender la question énergétique dans le bon sens, c’est-à-dire en partant des besoins au lieu de l’offre.
Par ailleurs, la faillite de l’entreprise Photowatt, le retard français dans le développement de l’éolien, du photovoltaïque et de la biomasse, alors que la France possède le meilleur potentiel en Europe, ne s’expliquent que par le primat du nucléaire et la volonté de ne pas laisser ces alternatives lui prendre de la place. Ce n’est pas le nucléaire qui sert la politique énergétique mais l’inverse, d’où un débat systématiquement biaisé.
La France se caractérise par le monopole d’EDF sur le transport et la distribution de l’électricité – l’activité de production et de vente ayant été ouverte à la concurrence. Ce système unifié, intrinsèquement lié à notre conception du service public de l’énergie, ne rend-il pas difficile l’essor des énergies renouvelables ? Ne sera-t-il pas nécessaire de réformer ce système pour accélérer la transition énergétique ?
Autour de l’acteur EDF, on trouve une gestion unifiée du parc de production, du réseau de transport d’électricité, d’une très large partie de sa distribution mais aussi de l’ensemble des règles tarifaires – puisque une grande majorité des consommateurs restent dans le tarif régulé. Cela permet à l’acteur public de tirer toutes les ficelles. De là, tous les débats sur la réalité des coûts du nucléaire. Le tarif de l’électricité ne reflète pas les nécessités économiques en termes de coût de production, ni la nécessité des investissements massifs à venir dans la sûreté et le réseau. D’où la demande formulée aujourd’hui par EDF d’augmenter de 30 % les tarifs d’électricité.
Le système électrique est pensé en fonction du nucléaire et en défense de ce choix. La transition énergétique ne se fera pas sans réformer ce modèle. Historiquement, il s’est produit une sorte d’assimilation entre le choix nucléaire, le service public EDF et la protection des consommateurs français en termes de tarif d’électricité. Or il existe un capital énorme de sympathie pour le modèle du service public national, qui renvoie à l’héritage du Conseil national de la résistance. Ce sont des choses ancrées profondément, et qui sont intégrées comme participant de l’intérêt général. Le programme nucléaire est en partie assimilé à ce système.
L’un des paradoxes de la situation actuelle, c’est qu’EDF s’éloigne de ce modèle, en se comportant de plus en plus comme un acteur privé jouissant d’un monopole public. Mais tout en conservant cette image extrêmement positive auprès des Français. EDF profite clairement de cette situation pour capter la rente que constitue le nucléaire historique et la détourner de l’intérêt général.
Une illustration de ce phénomène est donnée par la décision qu’EDF a prise, avec l’aval de son actionnaire l’Etat, fin 2010, d’inscrire dans le fond séparé de provisions pour le démantèlement futur des installations nucléaires la moitié de la valeur en actifs du réseau de transport d’électricité. Cela représente 2 milliards d’euros. Alors que ce fond est censé garantir les provisions disponibles pour le démantèlement, on y inscrit quelque chose qui, non seulement n’est pas disponible, et en plus fait partie des bijoux de famille de cet héritage de la nationalisation de 1946 !
Les Français ont payé le développement de ce réseau, paient sur chaque kWh des provisions pour le démantèlement. Mais cette décision va conduire, quand on va démanteler, à avoir le choix entre se séparer du réseau de transport, en clair le vendre au privé pour obtenir les liquidités, ou alors, payer le démantèlement une nouvelle fois ! Cela va, sans aucune contestation possible, contre l’intérêt général. Il n’y a eu aucun débat public sur le sujet.
Si l’on ajoute à cela le fait qu’EDF a comme principal intérêt aujourd’hui de défendre son parc nucléaire, de l’utiliser le plus longtemps possible à moindre coût, de résister au développement trop important des renouvelables et de la maîtrise de la consommation, on peut dire que ses intérêts vont contre l’intérêt général énergétique à long terme. Il y a donc un besoin urgent de réinventer un modèle pour le secteur, où l’on pourra préserver les acquis, en laissant de côté toutes les évolutions négatives des dernières années. L’acquis de service public est extrêmement important.
Ce qui manque, c’est le lien entre les échelons national et local. On a l’exemple de la mobilisation sociale dans la transition énergétique que facilite le caractère décentralisé du système allemand. Dès que les projets ont trait à une maîtrise publique locale ou coopérative, l’acceptabilité est beaucoup plus grande. Par exemple, il n’y a pas d’opposition aux fermes éoliennes développées dans le cadre d’une régie publique d’électricité.
On retrouve ici le lien auquel les Français sont attachés entre l’intérêt public et le développement des outils de production. Dans le cas du programme nucléaire, à partir du moment où l’équation économique est devenue mauvaise, et où le parc s’est trouvé en surcapacité, les choix faits se sont de plus en plus éloignés de l’objectif de moindre coût et de meilleur service pour la communauté. A l’inverse, au niveau local, le développement maîtrisé des outils de production peut se faire en lien avec les besoins. La décentralisation est indispensable car les gisements d’économie d’énergie et de renouvelables, qui sont à portée de main, sont locaux.
Le quinquennat de Nicolas Sarkozy a débuté avec le lancement du Grenelle de l’environnement, d’abord encensé comme le lancement d’un « new deal » écologique, mais décrié désormais par les associations et mouvements écologistes pour ses faiblesses. N’était-il pas dès le départ condamné à l’inefficacité, du fait d’avoir exclu le nucléaire de son périmètre de réformes ?
Le Grenelle a été un vrai moment de concertation et de construction d’un consensus sur la question énergétique, avec des avancées réelles dans la réflexion et les objectifs. Mais cet espace de discussion n’a pu fonctionner que par le choix initial de laisser le nucléaire hors du champ. C’était fou puisqu’on voit que le nucléaire structure tout le reste et, en même temps, je fus le premier à considérer à l’époque que c’était peut-être une façon d’avancer sur les deux priorités de la transition énergétique : l’action sur les consommations d’énergie et le développement des renouvelables.
En fait, le paradoxe s’est avéré mortel. Une fois le Grenelle terminé, l’administration et les politiques ont fait l’addition du Grenelle et du choix du nucléaire, comme si ces deux choses étaient compatibles. En réalité, elles ne le sont pas. Cela s’est traduit par un scénario énergétique improbable, élaboré par la Direction générale de l’énergie et du climat du ministère de l’écologie. Pour la première fois, les pouvoirs publics ont proposé un scénario de baisse immédiate de la consommation énergétique. Sauf que leurs prévisions tablaient à la fois sur le maintien du niveau nucléaire et sur 20 % d’énergies renouvelables – requis par nos engagements européens. Le problème, c’est que la somme de ces projections conduit à un fort excédent d’électricité.
La conclusion du ministère a été de boucler le scénario par une augmentation sans fondement du solde exportateur. La France, qui a connu un pic d’exportations de 70 TWh au début des années 2000, devait parvenir à exporter presque le double, 130 TWh, ce qui est hautement improbable dans un marché beaucoup plus libéralisé et fluide. Quand j’ai demandé quelle étude fondait la faisabilité de cet objectif, la réponse a été : aucune. C’était une façon de ne pas reconnaître que ces objectifs du Grenelle et le statu quo nucléaire étaient en fait contradictoires.
François Hollande veut ramener la part d’électricité d’origine nucléaire à 50 % en 2025, contre 75 % aujourd’hui. Cet objectif vous semble-t-il cohérent ?
Il y a une ambiguïté sur l’objectif à plus long terme, et une incohérence à plus court terme. Nous sommes pris dans un jeu de contraintes créé par la vitesse de réalisation du programme nucléaire français – 80 % des réacteurs ont été mis en service entre 1977 et 1987 –, par la durée de vie prévue à la conception de ces réacteurs, et la remise en question de leur sûreté après Fukushima.
Un objectif de fonctionnement sûr de ces tranches après 30 ans et jusqu’à 40 ans est aujourd’hui tout à fait incertain, sans parler des projections au-delà. Les “stress test” le montrent bien : il y a tout un travail à faire de réévaluation des exigences de sûreté. Par exemple, le processus de vieillissement des cuves de certains réacteurs est bien connu, et il renforce le risque d’accident.
50 % d’électricité en 2025 – sous réserve que la consommation d’électricité se stabilise – signifie la fermeture d’un tiers du parc. Le problème, c’est qu’avant 2027, juste deux ans plus tard, ce n’est pas un tiers du parc actuel mais 80 % des réacteurs qui atteignent 40 ans. Il n’est pas réaliste d’imaginer fermer la différence, soit la moitié du parc, en deux ans, entre 2025 et 2027.
Donc cet objectif pour 2025 soit devra être revu avec plus d’ambition, soit conduira à la construction de nouveaux réacteurs ou entraînera la prolongation de la durée de vie d’une quinzaine de réacteurs au-delà de 40 ans. Un tel prolongement paraît en l’état des connaissances extrêmement risqué. Je crois que c’est sincèrement que François Hollande s’est orienté vers cette position qu’il a perçue comme un compromis. Mais le compromis avec la sûreté n’est pas possible.
Avec les experts de l’association Négawatt, nous avons calculé que l’horizon de fermeture du parc actuel, à la fois nécessaire du point de vue de la sûreté et raisonnable du point de vue de la transition énergétique, se situe entre 2030 et 2035.
C’est une fenêtre très étroite. Surtout, elle ne pourra être atteinte que si l’on prend très vite la bonne pente. C’est-à-dire si on ferme rapidement des réacteurs, parce que dans un système où le nucléaire est en surcapacité, il faut faire de la place physiquement et économiquement aux énergies renouvelables, et aux actions efficaces de maîtrise de la demande d’électricité.
Si on ne fait pas ça, s’il n’y a pas d’impulsion forte pendant la prochaine mandature, c’est là que le risque d’échec est réel. Et le risque de se retrouver confrontés dans une dizaine d’années à un choix impossible, entre fermer les réacteurs sans avoir mis en place les solutions alternatives, ou les prolonger dans des conditions de sûreté dont on ne pourra pas nier qu’elles sont extrêmement dégradées.
Presque un an après l’accident de Fukushima, la façon dont on débat de l’énergie en France s’est-elle profondément modifiée ?
Le changement pour les experts non institutionnels comme moi est manifeste. Le besoin d’expertise existait déjà avant. Mais le choc de Fukushima est plus profond que ça. Depuis des années, et même des décennies, la politique énergétique française était un non-sujet politique : le nucléaire était installé dans l’esprit des gens, même s’ils n’y étaient pas nécessairement favorables. Les décisions étaient confisquées, du fait que les responsables politiques déléguaient avec beaucoup de satisfaction cette question technique qui ne les intéresse pas fondamentalement aux administrations et au Corps des Mines.
Pendant trois, quatre décennies, la politique énergétique s’est donc construite sur la politique nucléaire. C’était insensible aux alternances politiques. Je crois que cette parenthèse historique s’est refermée avec Fukushima, qui a créé un besoin plus profond de se dire qu’une alternative au nucléaire est possible. C’est insupportable pour la société française de se sentir condamnée au choix nucléaire et condamnée, peut-être, à une catastrophe. C’est manifeste dans l’évolution de l’offre politique en vue des prochaines échéances électorales.
Pourtant les intentions de vote pour Eva Joly, la seule candidate à mener aussi volontairement campagne pour la sortie du nucléaire, sont très faibles dans les sondages.
Il y a peut-être un paradoxe. Ce besoin qui s’exprime se joue dans d’autres mouvements politiques que le mouvement écologiste. Il se joue dans les débats qui s’ouvrent en interne, et dans les évolutions des hommes et femmes politiques. On l’a vu notamment au Parti socialiste, dans le cadre de la primaire, avec les prises de position très engagées de Martine Aubry, et celles, moins radicales mais qui rompent avec les lignes antérieures, de François Hollande. Ségolène Royal s’est aussi plus ou moins prononcée pour une sortie du nucléaire.
Du côté de la gauche du PS, les choses évoluent aussi fortement. Le candidat du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, s’exprime pour une sortie du nucléaire mais compose avec un Parti communiste dont la ligne officielle reste la continuation du programme.
Un véritable espace de débat s’est donc créé. Mais on constate aussi l’inculture massive des acteurs médiatiques et politiques. Par exemple, la plupart d’entre eux ne connaissent pas la différence entre l’énergie primaire et l’énergie finale, qui distingue la quantité d’énergie mesurée au niveau de la ressource de celle de votre consommation. Or la différence est extrêmement importante car, entre les deux, se joue tout le rendement de la chaîne énergétique. C’est-à-dire, la quantité d’énergie nécessaire pour produire et transporter l’électricité à partir de l’uranium, du pétrole, ou d’un rayon de soleil…
Or en France, une large part du débat tourne autour de la façon dont on cache ou révèle la très mauvaise performance du nucléaire : seulement 33 % de l’énergie libérée dans la chaudière nucléaire est livrée sur le réseau. Si bien que des pertes massives de chaleur se dissipent dans nos rivières et dans les airs. Ce sont ces grands panaches de vapeur qui s’échappent des fameuses tours aéro-réfrigérantes des centrales nucléaires.
Cette inculture énergétique forte des acteurs politiques, des médias et du grand public permet à certains mythes fondateurs de perdurer. Comme celui de l’indépendance énergétique.
Pourquoi parlez-vous de mythe ?
L’indépendance énergétique mesure le ratio entre l’énergie produite et consommée en France. Pour la calculer, on compte l’énergie produite dans les centrales nucléaires, les centrales hydro-électriques, l’éolien, le photovoltaïque… que l’on rapporte à ce que l’on consomme, déduction faite de la part d’électricité qu’on exporte. On y ajoute, enfin, tout le pétrole, le gaz et le charbon qu’on importe pour faire fonctionner nos voitures et nos chaudières.
Le chiffre officiel, c’est que la France produit à peu près 50 % de l’énergie qu’elle consomme. Ce taux a doublé par rapport à l’époque du premier choc pétrolier, où il était environ de 25 %. Or derrière cette vision très favorable, il y a deux conventions éminemment contestables : la première, c’est de prendre en compte l’énergie primaire et non l’énergie finale. Du coup, toute la chaleur gaspillée par les réacteurs du fait de leur mauvais rendement est comptée comme une énergie qu’on est content d’avoir produite et consommée. Le paradoxe, c’est que si on avait des réacteurs encore moins performants, avec 10 % ou 5 % de rendement seulement, on augmenterait complètement artificiellement cette indépendance énergétique !
La deuxième convention majeure dans ce calcul, c’est de considérer que l’énergie nucléaire est produite en France, en évacuant le fait que l’uranium qui sert à la produire est totalement importé. Ainsi, quand vous importez du pétrole brut, que vous le raffinez en France, et que vous le brûlez dans une centrale thermique pour produire de l’électricité, c’est comptabilisé comme une importation d’énergie. Mais quand vous importez de l’uranium, que vous l’enrichissez en France, et que vous l’utilisez dans une centrale pour fabriquer de l’électricité, c’est une production domestique.
Résultat : si on remplace ces deux conventions par un calcul en énergie finale, et en comptant l’uranium comme une énergie importée, on n’est plus sur une hausse de 25 % d’indépendance énergétique en 1973 à 50 % aujourd’hui, mais sur une baisse de 30 % en 1973 jusqu’à 15 % seulement aujourd’hui.
Ces deux conventions sont par nature deux représentations discutables du réel. Mais a minima, la seconde me paraît mieux représenter les enjeux de la situation actuelle. C’est un débat que les associations et les experts non institutionnels portent depuis des années. La comptabilité officielle ne changera pas parce que ce chiffre de 50 % a pris au fil des ans le statut d’un mythe. Il n’est plus discutable et sert de justification absolue à la poursuite du programme nucléaire. L’existence d’un lobby fort d’un côté, et l’inculture générale de l’autre, permettent de maintenir des biais incroyables dans l’analyse statistique de notre bilan énergétique.
Pensez-vous que le nucléaire puisse jouer un rôle d’énergie de transition ?
La question est en effet aujourd’hui de savoir si le nucléaire, dont on ne peut plus raisonnablement soutenir qu’il est durable dans sa forme actuelle, est une énergie du passé ou une énergie de transition qui a sa place pour aller vers un autre système énergétique. Comme nous l’avons vu, le nucléaire est dans le cas de la France un obstacle à la transition énergétique.
À l’inverse, le pays le plus engagé aujourd’hui dans la transition énergétique est l’Allemagne. Il y a une cohérence entre la volonté réaffirmée de sortir du nucléaire, les ambitions que l’Allemagne se donne dans la maîtrise de l’énergie et la montée des renouvables, et un lien évident avec la façon dont les acteurs – la société civile, les politiques, les industriels – se mobilisent pour atteindre ces objectifs.
Ce qui est très frappant quand on compare les discours, c’est qu’en Allemagne les orientations politiques sont portées par une vision à long terme. En France, la vision qui structure la politique énergétique, c’est l’ambition de maintenir le choix nucléaire. On est allé au bout de cette perspective avec 75 % de nucléaire dans l’électricité, ce qui est sans équivalent dans le monde. On a poussé aussi loin que possible les usages de l’électricité, parfois de la façon la plus absurde comme avec l’équipement massif des bâtiments en chauffage électrique.
Ce système est à bout de souffle. Sa prolongation n’est pas une perspective pour faire avancer la donne énergétique.
On le voit dans l’évolution du bilan énergétique : nous ne parvenons pas à atteindre les objectifs que nous nous fixons. Part des renouvelables en 2010 fixée par la loi POPE en 2004, objectif de renouvelables et d’économies d’énergie pour 2020, horizon de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre en 2050 : nous ratons ces échéances ou sommes en mauvaise voie pour les respecter. Cela montre bien que le système n’est pas mobilisé vers les objectifs fixés. Il n’y a pas de tendances claires. Alors que la transition énergétique est chaque jour un peu plus une urgence, la seule tendance, c’est le statu quo.
À voir également sur le site :
Le vieillissement des installations nucléaires : un processus mal maîtrisé et insuffisamment encadré
Yves Marignac, Contrôle, dossier n°184 : « La poursuite d’exploitation des centrales nucléaires », juillet 2009
Nucléaire : par ici la sortie
(Rapports, analyses, tribunes, interviews, etc. : les propositions de Global Chance et de ses membres pour, enfin, sortir du nucléaire)
Fukushima : réactions en chaîne
(Tribunes, analyses, interviews, etc. : les réactions des membres de Global Chance face à la catastrophe nucléaire de Fukushima)
 Global Chance
Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992
Global Chance
Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992