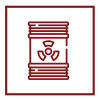Bernard Laponche
Entretien avec Charlotte Nordmann
La Revue internationale des Livres et des idées, n°14, novembre-décembre 2009
Lorsqu’on parle du nucléaire, le problème est de savoir par quoi commencer. Dans le tissu de mensonges qui servent à justifier l’emploi de cette technologie, lequel dissiper en premier ? Parmi tous les dangers extrêmes dont il est porteur (risque d’accident, déchets dont on ne sait que faire, prolifération), par lequel commencer ? La question – à l’heure où une nouvelle stratégie se met en place, qui espère le faire apparaître comme un remède « écologique » au réchauffement climatique – est dès lors de comprendre comment il a pu nous être autoritairement imposé.
Bernard Laponche, polytechnicien, a été ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique jusqu’au milieu des années 1970. Il est aujourd’hui consultant international en politiques et maîtrise de l’énergie, et a été conseiller pour l’énergie et la sûreté nucléaire auprès de la Ministre de l’environnement Dominique Voynet en 1998-1999. Il est notamment l’auteur de Maîtriser la consommation d’énergie.
Charlotte Nordmann est l’auteure de Bourdieu/Rancière. La politique entre sociologie et philosophie et de La Fabrique de l’impuissance 2. L’école, entre domination et émancipation. Elle est membre de l’équipe éditoriale de La Revue internationale des Livres et des idées.
Télécharger l’entretien dans sa mise en page d’origine (pdf – 4,3 Mo)
Lire seulement une sélection d’extraits
Charlotte Nordmann : Pour commencer, quel est le principe physique au fondement de l’énergie nucléaire ?
Bernard Laponche : Il est important en effet de comprendre le principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire et aussi de connaître l’historique de l’industrie nucléaire.
L’utilisation de l’énergie nucléaire est basée sur deux phénomènes physiques : la fission et la réaction en chaîne. Je m’explique. Tous les corps dans la nature sont constitués de molécules, édifices plus ou moins complexes d’atomes. Chaque atome est lui-même un assemblage de trois particules : proton, neutron et électron. Les protons et les neutrons, ou nucléons, sont soudés entre eux par des forces extrêmement puissantes, ou forces nucléaires, au sein du noyau de l’atome, autour duquel gravitent les électrons. Les noyaux des éléments naturels sont en majorité stables. La fission spontanée, qui consiste en l’éclatement d’un noyau d’un élément lourd [1], est possible mais très rare dans la nature.
Dans la croûte terrestre, on trouve du minerai d’uranium, qui est constitué de deux principaux isotopes : l’uranium 238 et l’uranium 235 (0,7 %). Ce dernier est « fissile », c’est-à-dire que, lorsqu’un noyau d’uranium 235 est « percuté » par un neutron, celui-ci provoque la fission du noyau. Celle-ci est, à cette échelle minuscule, une explosion très violente qui produit des fragments de l’ancien noyau et deux ou trois neutrons. L’énergie ainsi libérée par la fission, ou « énergie nucléaire », est considérable : la quantité d’énergie libérée par la fission de tous les noyaux d’un gramme d’uranium 235 est égale à celle qui serait libérée par la combustion complète de 2,5 tonnes de charbon. Les fragments produits par la fission deviennent les noyaux d’éléments plus légers, dont les atomes se retrouvent dans un état instable. Ils sont « radioactifs » et émettent, pour revenir dans un état stable, des particules ou des rayonnements extrêmement dangereux : on les appelle les « produits de fission ».
Les deux ou trois neutrons produits par chaque fission peuvent à leur tour aller « fissionner » d’autres noyaux d’uranium 235, ces nouvelles fissions produisant de nouveaux neutrons, etc. C’est la « réaction en chaîne ». Pour qu’elle s’établisse, il faut rassembler en un même volume une masse suffisante de matériau fissile.
Ces découvertes sont relativement récentes : le neutron a été découvert en 1938, la fission et la possibilité de réaction en chaîne un peu après. C’était à la veille de la seconde guerre mondiale et leur première application allait être « la bombe atomique ». Et pour cela, on a développé, dans le gigantesque Projet Manhattan aux États-Unis, les technologies de l’enrichissement de l’uranium afin de produire de l’uranium 235, ainsi que les premiers réacteurs nucléaires et le retraitement des combustibles irradiés pour produire du plutonium.
Quel est l’intérêt de l’enrichissement ?
Plus la proportion d’uranium 235 est élevée dans un volume donné, plus vous pouvez produire de fissions et plus la réaction en chaîne sera rapide. Très concrètement, avec 10 kg d’uranium presque pur en isotope 235, on peut faire une bombe nucléaire : la réaction en chaîne est tellement rapide et l’énergie libérée tellement puissante que le phénomène provoque une explosion de très grande puissance de destruction, à la fois par le dégagement de chaleur et par la radioactivité de tous les éléments dispersés par l’explosion.
L’autre façon de fabriquer un explosif nucléaire est de produire du plutonium 239. Pour cela, on a réalisé des « réacteurs nucléaires ». Dans un réacteur nucléaire, on dispose du combustible dans une cuve, sous forme de plaques ou de « crayons » de métal ou d’oxyde d’uranium naturel ou légèrement enrichi. C’est dans ce combustible que vont se produire les fissions et la réaction en chaîne. Comme il se trouve que plus les neutrons issus de la fission sont lents, plus ils produisent de fissions, on installe autour des crayons combustibles un « modérateur » ou ralentisseur de neutrons qui peut être du graphite, ou de l’eau ordinaire, ou de l’eau lourde [2]. Puisque les fissions dégagent de la chaleur, on fait circuler dans la cuve, ou cœur du réacteur, un fluide réfrigérant (ou caloporteur si l’on veut récupérer la chaleur produite). Les fissions des noyaux d’isotope 235 produisent des neutrons ; une partie de ceux-ci vont percuter des noyaux de l’isotope 238, et produisent ainsi du plutonium 239. On retire alors les éléments combustibles dits « combustibles irradiés » du réacteur et, par un traitement chimique appelé « retraitement », on en extrait le plutonium 239, qui est lui-même fissile. Il peut donc constituer la matière première d’une bombe nucléaire. En 1942, à Chicago, le premier réacteur nucléaire, que l’on appelait alors « pile atomique », a produit pour la première fois du plutonium.
Il y a eu deux bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 : l’une était à l’uranium très enrichi et l’autre au plutonium.
On voit ainsi apparaître dès cette époque trois grandes techniques permettant l’utilisation de l’énergie nucléaire : l’enrichissement de l’uranium, le réacteur nucléaire et le retraitement du combustible irradié pour produire du plutonium.
Toutes ces technologies existent dès la seconde guerre mondiale. Puis, toujours pour les besoins militaires, le réacteur « à eau ordinaire et uranium enrichi » sera développé dans les années 1950 comme « moteur » des sous-marins nucléaires américains (mais aussi russes, anglais et plus tard français).
Mais qu’en est-il des centrales nucléaires qui produisent de l’électricité ?
Déjà, avant la guerre, des scientifiques avaient pensé qu’il pourrait être intéressant d’utiliser la chaleur produite par la fission. En effet, si on récupère cette chaleur pour faire chauffer de l’eau et produire de la vapeur, on peut faire tourner des turbines et produire de l’électricité.
Dès les années 1950, on a donc développé les premiers réacteurs producteurs d’électricité. En 1954, dans son discours « Atom for Peace », Eisenhower, président des États-Unis, a ainsi défendu l’idée que les technologies mises au point pour des fins militaires devaient désormais être mises au service d’usages civils ou pacifiques, pour la production d’électricité. Cette « rédemption » de l’atome par son utilisation civile était aussi une remarquable opération commerciale pour les firmes nucléaires américaines Westinghouse et General Electric.
Pourquoi insister sur cette histoire, sur l’origine des technologies nucléaires et sur le lien entre nucléaire civil et nucléaire militaire ? C’est qu’il est important de bien voir que toutes ces technologies ont d’abord été développées pour des besoins militaires, et seulement dans un second temps pour des usages civils. On a donc changé l’objectif, mais pas les technologies.
D’après vous, cette origine militaire du nucléaire civil a vraiment des conséquences déterminantes ?
Sans aucun doute, et sur plusieurs plans. Le CEA, Commissariat à l’énergie atomique, est resté, depuis sa création dès la fin 1945, responsable à la fois du développement du nucléaire militaire et de ses applications industrielles civiles. L’interaction entre civil et militaire est illustrée en particulier dans les activités liées au combustible nucléaire qui ne sont pas distinctes entre les deux domaines. Cette origine militaire, aussi bien des techniques que des organismes, a perpétué la culture du secret qui reste l’une des caractéristiques de l’industrie nucléaire civile.
Il n’est pas possible de comprendre le développement du nucléaire civil si l’on ne considère pas que, dans la plupart des pays et en particulier en France, il est solidaire de celui du nucléaire militaire. D’abord, nous l’avons vu, par les technologies, ensuite, par le fait que l’industrie nucléaire a reçu de façon constante un soutien de l’État dépassant largement la politique industrielle, enfin parce que certains programmes dits civils ont largement contribué au développement militaire.
Il est à peu près certain que des considérations d’ordre militaire sur la nécessité de prévoir une large capacité de production de plutonium de qualité militaire ont joué dans la décision prise en 1976 de construire Superphénix, un « surgénérateur » ou réacteur à neutrons rapides alimenté au plutonium, et d’augmenter considérablement les capacités de l’usine de retraitement de La Hague. C’était aussi l’époque des choix stratégiques glissant de l’arme nucléaire stratégique à l’arme tactique de bataille (ce qu’on a appelé les armes « Pluton ») requérant des quantités bien supérieures de plutonium – sans même parler du développement envisagé de la « bombe à neutrons » [3].
Il est d’ailleurs remarquable que, même après l’arrêt de Superphénix, on n’ait pas arrêté pour autant le retraitement et la production de plutonium, comme l’aurait voulu la logique industrielle. On a continué à produire du plutonium, et on l’a utilisé pour produire des combustibles qu’on appelle les combustibles MOX, mélange d’oxyde d’uranium, c’est-à-dire d’uranium appauvri, et de plutonium, malgré le coût élevé de ce procédé, et bien que la fabrication comme le transport du MOX posent d’importants problèmes de sécurité.
Parce que ces technologies ont été mises au point pour les besoins militaires, des considérations qui auraient dû être décisives ont été négligées : on ne s’est pas suffisamment soucié du risque que présentaient ces installations, ni surtout de la question des déchets.
Les techniques développées pour l’utilisation de l’énergie nucléaire étaient sans doute parfaitement adaptées pour la production de bombes (encore que l’on ait bien fait semblant d’ignorer les risques que courraient ceux qui participaient aux fameux « essais nucléaires »), mais elles sont bien trop complexes, et bien trop dangereuses, pour cet objectif banal qu’est la production d’électricité. D’une certaine façon, c’est un peu comme si on avait développé le moteur à explosion en utilisant la poudre à canon. Cela aurait probablement marché, mais avec quelques risques.
Mais quels sont les risques, justement ?
Il y a trois types de risques lourds. Le premier, c’est le risque d’accident grave, qui peut intervenir à la fois dans une centrale nucléaire et dans les industries du combustible. La fabrication du MOX est ainsi particulièrement problématique, car le plutonium est un corps très dangereux. Il faut bien avoir conscience que la sûreté nucléaire ne concerne pas uniquement les réacteurs. C’est ce qu’ont rappelé au grand public les incidents survenus au Tricastin et à Romans-sur-Isère en juillet 2008, avec la dispersion d’uranium dans l’environnement autour de sites d’installations nucléaires liées à la conversion et à l’enrichissement de l’uranium, et à la fabrication de combustible – mais de tels incidents ne sont pas rares. Plus récemment, ont ainsi été révélées les erreurs sur la comptabilité de la quantité de plutonium traité dans l’atelier de plutonium de Cadarache (ATPu). Il y a donc un risque d’accident grave qui concerne à la fois, dans des formes différentes, les centrales, les usines, les transports de matières radioactives et l’entreposage ou le stockage de déchets.
Dans une centrale nucléaire à eau sous pression (PWR, ou REP), qui est le modèle des réacteurs équipant les centrales actuelles, l’accident majeur résulterait de la perte de refroidissement entraînant une fusion partielle ou totale du « coeur » (l’ensemble des éléments combustibles) du réacteur nucléaire. Un tel accident peut intervenir soit du fait de la rupture de la cuve du réacteur ou d’une tuyauterie du circuit primaire, soit du fait d’une défaillance totale du système de refroidissement.
Or les causes possibles de rupture ou de défaillance des systèmes de refroidissement sont multiples : un tel accident peut être causé par des actes de sabotage, mais aussi par un séisme, ou encore par des perturbations météorologiques extrêmes (par exemple, des inondations), des missiles externes (on peut penser à la chute d’un avion), ou encore par une accumulation d’erreurs humaines dans la conception, la construction ou l’exploitation de l’installation. De telles possibilités nous sont aujourd’hui présentées comme négligeables, mais elles doivent être prises en compte. Il n’est pas possible de ne pas prendre en compte le risque d’attaques terroristes ou de guerre, ni celui que constitue la multiplication actuelle des phénomènes météorologiques extrêmes.
Depuis l’accident de Tchernobyl en 1986, on sait en effet les conséquences dramatiques que peut avoir un tel accident, aussi bien sur la vie et la santé de centaines de milliers d’individus que sur l’environnement de régions très étendues : l’Ukraine a été contaminée, mais la Biélorussie, dont on parle peu, l’a été aussi.
Tchernobyl a été un moment de prise de conscience de ce qu’était un accident nucléaire, mais il y a aussi eu l’idée, comme l’accident avait eu lieu en URSS, que c’était une situation tout à fait particulière, due à la fois au système de pouvoir et à la vétusté des installations nucléaires.
Le modèle des réacteurs équipant la centrale de Tchernobyl avait une longue expérience de fonctionnement et ces réacteurs étaient considérés comme très sûrs. Le nucléaire soviétique avait, avant l’accident, une très bonne réputation auprès des milieux nucléaires occidentaux. D’ailleurs, ce n’est pas le seul accident majeur qui soit survenu : il y a aussi eu Three Mile Island, qui a eu lieu en 1979 aux États-Unis. À la suite de défaillances techniques et d’erreurs humaines, le coeur du réacteur a fondu. On s’est trouvé à la limite de la catastrophe : la bulle d’hydrogène qui s’était formée pouvait tout à fait exploser et le gouvernement a eu raison d’évacuer la population. Cela fait donc deux accidents majeurs, dont l’un, par chance, a eu surtout des conséquences économiques et industrielles. Cet accident a néanmoins porté un coup d’arrêt au développement du nucléaire aux États-Unis, déjà très ralenti du fait de l’explosion des coûts d’investissement.
On commence à réfléchir à des réacteurs qu’on appelle « à sûreté intrinsèque » : si quelque chose ne fonctionne pas comme il devrait, tout s’arrête… Le danger majeur, dans les réacteurs PWR (pressurised water reactor, les réacteurs à eau sous pression, le modèle dominant aujourd’hui), intervient si l’alimentation électrique n’est plus assurée, et que l’alimentation de secours ne marche pas. Dans ce cas-là, c’est la catastrophe : la radioactivité est trop élevée, et le cœur fond, quoi qu’on fasse, comme à Three Mile Island. Il s’agirait d’imaginer des réacteurs dans lesquels ça ne se produirait pas.
Vous dites qu’on cherche à concevoir des centrales qui auraient cette sécurité intégrée, mais qu’on n’a pas encore trouvé ?
Non, pour l’instant, on n’a pas trouvé, le risque subsiste. Il est par exemple encore présent dans l’EPR, dans lequel on cherche à empêcher un accident majeur en ajoutant des dispositifs supplémentaires doublant ceux qui existent déjà, sans que la conception elle-même soit remise en question.
On nous présente l’EPR comme un réacteur plus sûr, mais on pourrait rappeler sur ce point les doutes de certains experts sur cette affirmation : en cas d’accident majeur, le core catcher (le réceptacle destiné à recueillir et isoler le coeur fondu du réacteur) et ses bassins de refroidissement pourraient s’avérer incapables de remplir leur fonction et de permettre le refroidissement du coeur, et au contraire provoquer de violentes explosions de vapeur, susceptibles de détruire l’enceinte de confinement ; de plus, les taux de combustion étant plus élevés et les combustibles irradiés plus radioactifs, l’impact d’un accident serait plus important qu’avec un autre type de réacteur ; enfin, il a été reconnu que le réacteur ne résisterait pas au choc frontal d’un avion de ligne [4].
Concernant l’EPR, on peut également citer les doutes des autorités de sûreté finlandaise (STUK) et britannique (NII) sur la capacité du nouveau système de contrôle-commande, plus complexe, à répondre aux exigences de base de la sûreté (« basic safety requirements »).
Ce qui est inquiétant, c’est qu’il y a eu, en France même, suffisamment de défaillances, depuis le démarrage de Fessenheim, la première centrale PWR installée en France en 1977, pour que l’on puisse parfaitement imaginer l’occurrence d’un accident grave. On peut citer trois exemples récents : l’erreur de conception du circuit de refroidissement à l’arrêt des réacteurs du palier N4 (1998), l’inondation de la centrale du Blayais par la tempête (1999) et le blocage possible en cas d’accident des vannes des circuits de refroidissement de secours des réacteurs du palier P4 (2001) [5].
Sur cette question de la vulnérabilité des installations nucléaires, le rapport de Global Chance, « Nucléaire, la grande illusion », est particulièrement éclairant. On peut en citer un passage, qui traite précisément de ce qui s’est produit à la centrale de Blayais :
« L’incident du Blayais-2 est ainsi une démonstration de la faiblesse de la perspective probabiliste [6] : du fait de la violence de la tempête qui a frappé la France le 27 décembre 1999, deux conditions critiques se sont combiné : une inondation centennale de la centrale et la perte de connexion au réseau électrique externe, entraînant un arrêt d’urgence alors même que certains équipements de sûreté clé n’étaient pas en état de fonctionner (pompes des circuits d’injection d’eau, circuits d’aspersion) et que toute intervention humaine était périlleuse vu les conditions météorologiques. Chacune de ces conditions avait été considérée comme suffisamment probable pour être prise en compte, mais pas leur survenue simultanée. Cet incident a d’ailleurs conduit à la révision des protections contre les inondations sur tous les sites [7]. »
À propos de la sûreté supposée des centrales en France, on pourrait citer aussi la phrase de Pierre Wiroth, inspecteur général pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, à EDF, en janvier 2008, qui exprime ainsi ses inquiétudes : « La baisse du coefficient de disponibilité [le rapport entre la quantité d’électricité que l’on pourrait produire en un temps donné et celle que l’on produit effectivement] est un clignotant pour la sûreté et doit interpeller : est-on suffisamment attentif aux compétences des équipes ainsi qu’à la qualité de la maintenance et au vieillissement des matériels [8] ? »
Plusieurs fois (et il y a plusieurs exemples dans d’autres pays), on est passé à côté de l’accident grave d’un cheveu, sans qu’on sache trop pourquoi – et pourtant cette possibilité de l’accident n’est jamais réellement prise en compte, aucun plan d’urgence sérieux n’étant par exemple élaboré. Transférons l’accident de Tchernobyl sur n’importe quel site de la vallée du Rhône, de la Loire ou du Nord de la France – rappelons que la centrale de Nogent-sur-Seine est à 80 km en amont de Paris –, et voyons si les collectivités locales, nationales et européennes sont prêtes à assumer ce risque. Moi, je prétends que non. Mais le problème n’a jamais été posé dans ces termes.
Les promoteurs du nucléaire ne nient pas d’ailleurs la possibilité d’un accident majeur, mais ils s’appuient sur le fait qu’il n’y a encore jamais eu d’accident grave en France même pour essayer de convaincre qu’il n’y en aura jamais parce que « toutes les précautions sont prises ». Mais le problème est qu’un tel accident est toujours possible, du fait de la nature des réacteurs nucléaires et des usines de combustibles.
Il faut d’ailleurs noter que l’AIEA (l’Agence internationale de l’énergie atomique) a toujours cherché à masquer l’ampleur de la catastrophe de Tchernobyl, allant jusqu’à soutenir, jusqu’à très récemment, que le nombre de victimes ne s’élevait qu’à 400, et ne reconnaissant aujourd’hui que 4 000 victimes, alors que celles-ci se comptent probablement en centaines de milliers [9]. D’après le ministre ukrainien de la Santé, 2,4 millions d’Ukrainiens, dont 400 000 enfants, souffrent toujours de problèmes de santé liés à l’accident de Tchernobyl.
Évidemment, et heureusement, il y a eu très peu d’accidents graves, sinon il y aurait bien longtemps qu’on aurait arrêté. Mais s’il y en a un qui se produit, ça peut être une catastrophe, et c’est ce que Tchernobyl a montré.
Tchernobyl a aussi montré que la première réaction des autorités nationales et internationales est toujours de minimiser l’accident et ses conséquences, ce qui implique de fait que les mesures de protection nécessaires ne sont pas prises à temps.
Mais le risque d’accident n’est pas le seul risque lié à l’industrie nucléaire, il y a aussi le problème des déchets ?
C’est le deuxième type de risque. Les combustibles restent à peu près trois ans dans le réacteur. Quand on les en sort, ce sont des « combustibles irradiés » qui contiennent encore en majorité de l’uranium mais aussi des « produits de fission » et des éléments lourds, dont le plutonium. Ils sont à la fois extrêmement radioactifs et extrêmement chauds. On les place alors dans des piscines, à côté des réacteurs, pour faire décroître leur température et leur radioactivité.
Pour la suite, il y a deux attitudes : la plupart des pays, dont les États-Unis, qui sont le pays où il y a le plus de réacteurs au monde, stockent les combustibles irradiés en l’état. Ils les conservent soit dans les piscines des réacteurs, soit dans des conteneurs entreposés sur les sites des centrales.
D’autres, dont les Anglais, et les Français – pour le moment, ce sont les seuls (les Japonais ont une usine en construction) –, ont des usines de retraitement, c’est-à-dire qu’ils traitent les combustibles irradiés, considérés ailleurs comme des déchets, pour récupérer le plutonium, et isoler la part la plus radioactive des déchets, qui est coulée dans du verre et stockée.
Mais ce qu’il est important de voir, c’est que le retraitement n’élimine absolument pas les déchets. On les sépare, on les trie, mais on ne s’en débarrasse pas. Pour l’instant, on n’a aucune solution.
Le retraitement n’est donc pas une solution ? Avec ce terme – EDF utilise même celui de « recyclage » –, on a l’impression qu’il y a une réutilisation des combustibles irradiés, et que le problème des déchets est réglé.
Oui, c’est bien ce qu’ils prétendent. Mais le retraitement des combustibles irradiés ne simplifie pas la question des déchets. Dans le meilleur des cas, l’opération qui consiste à isoler le plutonium pour ensuite produire du combustible MOX ne permet de réduire que de 15 % les déchets les plus actifs à très long terme (le plutonium et les actinides), ce qu’on appelle les déchets de type C. En revanche, elle entraîne une accumulation importante de déchets de moyenne activité, les déchets de type B. Le plutonium produit par l’opération, et censément destiné à être réutilisé, ne l’est en fait qu’en partie, de sorte qu’une quantité de plus en plus grande de plutonium non utilisé s’accumule, en dépit des déclarations d’intentions d’EDF. Fin 2006, le stock non réutilisé de plutonium, en croissance continuelle depuis 1987, était de 52,4 tonnes [10]. Enfin, le combustible MOX, élaboré à partir du plutonium isolé lors du retraitement, n’est pas lui-même retraité, et nécessite environ 150 ans de refroidissement contre 50 ans pour les combustibles classiques, avant un éventuel stockage.
Les pays étrangers qui avaient vu dans le retraitement à La Hague (ou à Sellafield, en Grande-Bretagne) des combustibles irradiés produits dans leurs centrales nucléaires le moyen de s’en débarrasser ne s’y sont pas trompés : successivement, l’Allemagne et la Belgique ont décidé d’abandonner cette opération coûteuse et d’étudier le stockage direct de leurs combustibles irradiés (ce que font déjà le Canada, les États-Unis, la Suède, etc.). En France même, EDF se pose sérieusement – derrière le discours officiel – la question de l’abandon du retraitement, qui lui coûte cher et ne résout pas ses problèmes de déchets.
En fait, la solution envisagée depuis le début par les développeurs du nucléaire est de « faire disparaître » les déchets, en les enfouissant à grande profondeur. Mais une telle décision pose des problèmes majeurs concernant des déchets à vie longue, qui seront encore radioactifs pendant des siècles, et jusqu’à des dizaines de millénaires.
Du fait des résistances à cette « solution », on pourrait s’orienter vers des stockages de longue durée en site protégé (en « subsurface »), qui laisseraient la possibilité de récupérer des matières qui s’avéreraient précieuses, en espérant que la recherche scientifique permettra un jour la neutralisation de ces déchets. C’est sans doute la moins mauvaise solution, mais il faut bien reconnaître que tout ça n’est pas très brillant.
Outre la question des déchets, il y a aussi une pollution permanente, en particulier dans les mines, qui ne sont plus en France mais au Niger aujourd’hui, et avec les rejets non pas certes des réacteurs, mais des usines de retraitement (on remarque ainsi que les autorisations de rejet de l’usine de La Hague sont jusqu’à 1 000 fois plus élevées que celles qui s’appliquent à la centrale voisine de Flamanville), et aussi les risques liés au transport des matières nucléaires d’un bout à l’autre du territoire national.
Il y a aussi le problème de la prolifération.
C’est le troisième risque majeur. Un pays qui engage un programme de développement du nucléaire civil se dote d’usines d’enrichissement, de fabrication de combustible et, éventuellement, d’une usine de retraitement, sur le modèle de la France. Or, les techniques d’enrichissement de l’uranium ou de production du plutonium par retraitement sont les mêmes qu’il s’agisse de produire des matériaux fissiles à des fins militaires ou civiles. Avec de l’uranium très enrichi ou avec du plutonium, il est possible de faire une bombe. Les technologies du nucléaire civil sont donc des vecteurs de prolifération du nucléaire militaire.
Il y a un élément proliférant dont on pourrait se passer, c’est le retraitement. Mais la France et l’Angleterre continuent à retraiter et le Japon cherche à démarrer sa propre usine. Il y a bien eu des tentatives… Le président Carter en particulier a tenté, en 1974, d’obtenir un accord international pour l’arrêt du retraitement. La France a été à la tête de ceux qui s’y sont opposés, et l’on n’a pas arrêté le retraitement.
Quant à l’enrichissement, pratiquement toutes les centrales nucléaires dans le monde sont sur le même modèle, PWR, qui fonctionne à l’uranium enrichi – donc, pour se passer de l’enrichissement, il faudrait changer entièrement de système. Ce n’est pas du tout ce qu’on fait : au contraire, on fait l’EPR et on nous le présente comme le réacteur du XXIème siècle. Mais l’EPR n’est pas du tout un réacteur de « troisième génération », comme l’affirment ses promoteurs, ce n’est que le dernier modèle de la deuxième génération, le dernier modèle des réacteurs PWR qui fonctionnent actuellement. C’est pour cela qu’il n’est pas plus acceptable que les autres : trop de risques sont associés à ce type de réacteurs, à la fois le risque de prolifération, avec l’enrichissement, le risque d’accident grave et celui des déchets.
Ce sont ces difficultés qui expliquent que, à part en France, le nucléaire ne se soit pas tellement développé dans le monde ?
Oui. Au début, dans les années 1950, on pensait qu’on allait produire de l’électricité tellement bon marché que ce ne serait pas la peine de mettre des compteurs… Il y avait une expression pour dire ça : « Too cheap to meter », trop bon marché pour être comptée. Les centrales nucléaires fonctionnant en base – c’est-à-dire de façon continue toute l’année, en dehors de pointes de production, pour lesquelles le nucléaire n’est pas adapté –, et sans problèmes techniques, produisent un kWh à un coût relativement compétitif, c’est vrai, mais les coûts d’investissement des nouvelles centrales ne cessent d’augmenter. Ce relatif avantage économique ne tient plus dès lors qu’on ajoute à ce coût les dépenses de la recherche publique sur le nucléaire et les « coûts futurs du nucléaire » (les coûts du démantèlement des centrales et de la gestion des déchets), qui sont difficilement estimables, mais sont sans conteste considérables. D’autre part, l’uranium est entièrement importé, ses réserves sont limitées et son coût ne reste bas que parce que le nucléaire ne se développe pas. Par ailleurs, du fait du risque d’accident, on a dû élaborer des systèmes de protection de plus en plus poussés, ce qui a entraîné des coûts qui n’avaient pas du tout été anticipés. Et puis, du fait même de ces risques, les assurances ne couvrent pas l’accident grave : tout repose sur l’État, donc sur les contribuables, voire sur des mécanismes de solidarité interétatiques.
C’est pour cela que le nucléaire a finalement été très peu développé, alors qu’il n’y a pas d’autre source d’énergie pour laquelle les États aient consacré autant de moyens, prenant en charge la recherche et développement, la question de déchets, toute la question du contrôle et même la garantie en cas d’accidents graves. Il faut bien voir que cette industrie ne s’est jamais développée dans des conditions de marché, mais toujours par une volonté politique et, dans beaucoup de pays, par la volonté politique de détenir l’arme nucléaire.
Le nucléaire représente assez peu dans la consommation d’énergie primaire mondiale. On dit que le nucléaire représente 6 % et que l’hydraulique plus l’éolien, etc., représentent à peu près 3 %. Ce qui déjà n’est pas beaucoup, mais, en plus, pour le nucléaire, on compte, dans l’énergie qu’on appelle l’énergie primaire, la chaleur produite dans le réacteur, et non la seule électricité.
Or il y a une importante déperdition de chaleur.
Une déperdition des deux tiers, si l’on considère l’énergie produite en amont, et non l’énergie utilisable. Si l’on tient compte de cette déperdition, on s’aperçoit que les renouvelables fournissent en fait plus d’électricité que le nucléaire.
Le nucléaire ne représente donc actuellement pas grand-chose, au niveau mondial. Donc si l’on décidait d’abandonner le nucléaire, ce serait un problème, mais certainement pas une catastrophe. Certes, ce serait compliqué pour la France, dont la consommation d’électricité repose à pratiquement 70 % sur le nucléaire (ce n’est pas 80 % parce que 80 %, c’est la production, qui inclut les exportations), ce qui est un record (par comparaison, l’Ukraine, le pays le plus dépendant du nucléaire après la France, dépend à 48 % de sa production). Mais cela dit, même pour la France, la sortie du nucléaire à la fin de vie technique des centrales nucléaires actuelles est parfaitement possible, et peut-être même à terme économiquement favorable, comme l’avait montré il y a déjà dix ans l’un des scénarios énergétiques du Commissariat général du Plan [11], surtout si l’on prend en compte les coûts de la technologie nucléaire dans son ensemble (recherche, sécurité nucléaire, démantèlement des centrales et des usines du combustible…).
Les Allemands ont eu l’intelligence de prendre la décision de sortir du nucléaire à temps, ce qui va permettre à leurs industries, à leurs villes et à leurs régions de se préparer à cette transition. Il est significatif que cette politique d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables soit soutenue par les industriels et les syndicats allemands.
Cette transition ne peut en tout cas se faire que par de grands programmes de meilleure utilisation de l’énergie et surtout de l’électricité, ce qui permettait de consommer beaucoup moins à service rendu égal. Il y a là, en particulier en France, un potentiel considérable.
Mais la France s’est construit une telle dépendance au nucléaire qu’effectivement l’idée d’arrêter semble…
C’est pour ça qu’en France il est considéré comme indécent, voire inacceptable, de critiquer le nucléaire. Dans la plupart des autres pays, on peut en parler, le nucléaire est considéré comme un moyen de production d’électricité dont on peut discuter, dont on peut examiner les mérites et les inconvénients.
Le raisonnement qui est tenu en France depuis quarante ans, c’est que tous les autres pays sont des imbéciles, que nous sommes les seuls à avoir raison et qu’un beau jour tout le monde va faire comme nous. Donc on continue à faire, imperturbablement, un EPR, deux EPR, etc., malgré les coûts, malgré les dangers… Et on investit massivement dans la recherche sur le nucléaire, au détriment de la maîtrise de la consommation d’énergie, au détriment du développement de systèmes décentralisés de production et d’utilisation de l’énergie, et des énergies renouvelables. Il est clair que la surcapacité du parc nucléaire français par rapport aux besoins est un frein à la fois aux économies d’énergie et au développement des énergies renouvelables.
Il faut savoir par exemple que le programme Messmer, le programme de construction massive de centrales décidé en 1973-1974, reposait sur une surestimation colossale de l’évolution de la consommation d’électricité. Je m’en souviens, j’étais à la commission « Énergie » du Plan. En 1975, la France consommait 175 milliards de kWh par an. L’argument pour justifier la construction de six réacteurs par an était que la consommation d’électricité allait doubler tous les dix ans. C’était considéré comme une loi absolue. On devait donc aboutir, en 2000, à environ 1 000 milliards de kWh. En fait, la production d’électricité en 2000 pour les 480 milliards de kWh. Ce qui est frappant, c’est que même lorsqu’il est apparu clairement, dès la fin des années 1970, que l’évolution réelle de la demande n’obéissait pas à cette « règle » du doublement tous les dix ans, on a maintenu un rythme élevé de construction de nouvelles centrales pendant toute la première moitié des années 1980, à la différence d’autres pays, comme par exemple les États-Unis, qui ont progressivement annulé toutes les commandes passées depuis 1973.
Du coup, la France a une surcapacité de production d’électricité, et se retrouve à exporter environ 80 milliards de kWh sur les 550 milliards de kWh qu’elle produit. Or, il n’a jamais été question de produire pour exporter, mais seulement pour les besoins intérieurs. Ce n’est que parce qu’on s’est trouvé en surcapacité qu’on s’est mis à exporter de l’électricité, mais, du point de vue économique, ça ne présente aucun intérêt [12], sans compter que les Français, sans s’en rendre compte, gardent pour eux les déchets, les risques, etc.
D’ailleurs, les pays qui achètent de l’électricité à la France le disent. Je pense à cette déclaration d’un ministre belge : « Si les Français sont assez idiots pour fabriquer du nucléaire, pour garder tous les problèmes chez eux et nous vendre de l’électricité, on ne voit pas pourquoi on s’en priverait ! »
Il a des parallèles étonnants. En 1974, on a présenté le nucléaire comme le garant de « l’indépendance énergétique » de la France, alors que le développement du nucléaire n’a diminué en rien notre dépendance au pétrole, puisque le secteur des transports, un secteur essentiel, en dépend toujours presque exclusivement – et même, curieusement, la consommation de pétrole par habitant de la France est supérieure à celle de nos grands voisins : Allemagne, Italie, Royaume-Uni.
Aujourd’hui, on nous présente le nucléaire comme la solution pour réduire nos émissions de CO2 – alors que c’est ce même secteur des transports qui pose le problème majeur, et que plus d’électricité n’y changerait à peu près rien !
Il n’est pas inutile de rappeler que, en France, la part de l’électricité dans la consommation d’énergie finale est de 21 %, de sorte que, la contribution du nucléaire à la consommation finale d’électricité étant de 67 %, la contribution du nucléaire à la consommation d’énergie finale de la France est seulement de 14 %. Mais alors, comment expliquer ce choix du nucléaire en France ? Comment se fait-il que les problèmes qui ont entravé le développement au niveau mondial du nucléaire n’aient pas joué de la même façon en France ?
En France, c’est la centralisation du pouvoir d’État qui a empêché toute intervention des citoyens dans le débat énergétique. Les mouvements d’opposition au nucléaire, pourtant aussi forts dans les années 1970 en France qu’en Allemagne, ne sont ainsi pas parvenus à infléchir les décisions prises au sommet de l’État. C’est cette centralisation qui explique l’obstination qui a présidé au développement du programme nucléaire français. On est vraiment face à une stratégie industrielle « napoléonienne », les grands choix technologiques étant le fait d’une caste restreinte au sein de l’État, par une alliance entre les grands corps d’État, notamment le corps de Mines, les entreprises et organismes publics et les préfets.
Le nucléaire a été transformé en domaine réservé de la « raison d’État », de sorte que la moindre critique est considérée comme une attaque contre l’intérêt de la nation. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’information dispensée par les instances officielles soit restée extrêmement indigente et que toute expertise indépendante ait été muselée.
Dans le milieu du nucléaire, que j’ai bien fréquenté, on pourrait distinguer trois catégories de personnes. Il y a tout d’abord des scientifiques, ou des ingénieurs – dont j’étais au début : eux trouvent ça très intéressant, et n’ont pas conscience des problèmes soulevés par le nucléaire. Jamais dans le service du CEA, où nous faisions des calculs sur les réacteurs, on ne nous a parlé des risques, ou des déchets. D’autres s’occupaient de ces questions (assez peu de celle des déchets, il faut bien dire). Tout est très compartimenté, et ceux qui travaillent là sont, pourrait-on dire, naturellement en faveur du nucléaire. C’est un peu leur boutique. Ce sont des gens qui font leur travail, qui sont assez sincères, et ne se posent pas trop de questions sur la finalité de ce qu’ils font.
Il y a une deuxième catégorie, que je dirais plutôt honnête, qui est assez consciente des risques, mais ne connaît en général pas très bien les questions énergétiques : ceux-là considèrent que les besoins en énergie sont tels qu’il n’est pas possible de faire l’économie du nucléaire. Et que l’on doit donc accepter les risques qui lui sont inhérents. Ils considèrent qu’ils sont juges aussi bien du risque que de son acceptation.
Or, s’il est vrai que les experts doivent contribuer à déterminer en quoi consiste le risque, la question de son acceptation n’est ni de leur compétence ni de leur responsabilité. C’est une décision fondamentalement politique, qui doit être prise par un processus démocratique. Il faudrait qu’on dise : voilà quels sont les risques, est-ce que vous les acceptez ou pas ? Il est probable que la plupart des gens ne les accepteraient pas. Mais à partir du moment où les risques sont masqués, cachés, niés…
La troisième catégorie de gens est en revanche réellement malhonnête. Ce sont d’ailleurs souvent des gens qui connaissent peu le nucléaire (et ne cherchent pas à le connaître), mais qui en vendent, des gens dont la carrière et l’argent en dépendent. Ceux-là mentent, purement et simplement. Ils sont prêts à soutenir que, non, il n’y a pas de risques, que, non, le plutonium n’est pas dangereux, que, non, il n’y a aucun problème avec les déchets, et ainsi de suite.
Avant, c’était le silence qui régnait sur tout ce qui touchait au nucléaire, mais aujourd’hui que la mode est à la communication, tous ces gens nous expliquent que, s’ils défendent le nucléaire, c’est par souci d’écologie, que le nucléaire est une énergie propre, qui ne pose aucun problème de sûreté, etc. Pour résumer : avant, c’était plutôt le verrouillage et, aujourd’hui, c’est plutôt le mensonge. La « transparence » – dont je ne nie pas la nécessité, mais à condition qu’elle soit sincère et contradictoire – devient le maître mot pour noyer le poisson.
Évidemment, cette dernière catégorie de gens ne se prive pas d’exploiter les deux premières, sans aucun scrupule.
Ce système nucléaire – je dis ce système, parce que c’est bien plus qu’un lobby – est extrêmement puissant, avec EDF, Areva, le CEA. Et parce qu’il est très puissant, plus précisément, au niveau de l’État, les politiques – à part les Verts et quelques autres – préfèrent ne pas s’en mêler et répètent qu’il n’y a pas de risque, que tous ceux qui sont opposés au nucléaire sont des antinucléaires primaires… Ils font le panégyrique du nucléaire, alors que, très souvent, leur ignorance sur le sujet est proprement sidérante. Cette chape de plomb s’étend d’ailleurs jusqu’aux médias, à quelques exceptions courageuses près, du fait notamment du pouvoir financier des entreprises du nucléaire, par le biais de la publicité, et la pression est également présente dans le milieu scientifique et à l’Université.
Tous ces gens-là, tant la haute administration que les politiques, considèrent le débat public comme un fardeau insupportable, comme quelque chose qu’il faut éviter à tout prix. Il y a pourtant des pays qui considèrent le débat public comme un élément important pour la prise de décision. En France, c’est tout au plus une obligation désagréable pour ces gens-là.
Il y a des images frappantes dans le film d’Éric Guéret et Laure Noualhat, Déchets, le cauchemar du nucléaire, qui est passé récemment sur Arte, ce sont celles de responsables de l’industrie nucléaire, comme par exemple Bernard Bigot, qui est « haut-commissaire à l’énergie atomique et (ex-)conseiller technique et scientifique auprès du gouvernement et du président », qui nous explique avec un sourire mielleux que la gestion des déchets nucléaires, c’est un peu comme, à une autre époque, la construction des cathédrales, que c’est la construction de l’avenir, et qu’il faut avoir « confiance », dans « le sens des responsabilités » des gens et dans la « science ». On a du mal à imaginer qu’il croit une seconde à ce qu’il raconte…
Il y a effectivement deux problèmes : il y a le problème du nucléaire lui-même, de ce qu’il est, de ses risques, et il y a le problème des gens qui s’en occupent. Cette population des dirigeants du nucléaire m’effraye à un point… Cette attitude de mépris extrême pour tout ce qui est en dehors de leur cercle, cette façon de décider de choix cruciaux hors de tout processus démocratique… Cette espèce de cynisme et d’arrogance, alors qu’il s’agit de faire de l’électricité… Non, je n’ai aucune confiance, aucune.
À lire également sur ce site :
Réchauffement climatique : le retour de la folie nucléaire, avec la présentation du numéro 14 de La Revue internationale des Livres et des idées et de l’article de Charlotte Nordmann et Jérôme Vidal intitulé « J’ai vu « l’Esprit du monde », non pas sur un cheval, mais sur un nuage radioactif : il avait le visage d’Anne Lauvergeon », mais aussi un résumé et une sélection d’extraits de l’entretien entre Bernard Laponche et Charlotte Nordmann.
Encadrés : Tchernobyl-sur-Seine, une impossibilité ? / Enfouir les déchets : une fuite en avant / Le nucléaire, arme de réduction massive du réchauffement climatique ? / Pouvons-nous nous passer du nucléaire ? - Pour aller plus loin (ressources bibliographiques et internet)
 Global Chance
Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992
Global Chance
Une expertise indépendante sur la transition énergétique depuis 1992